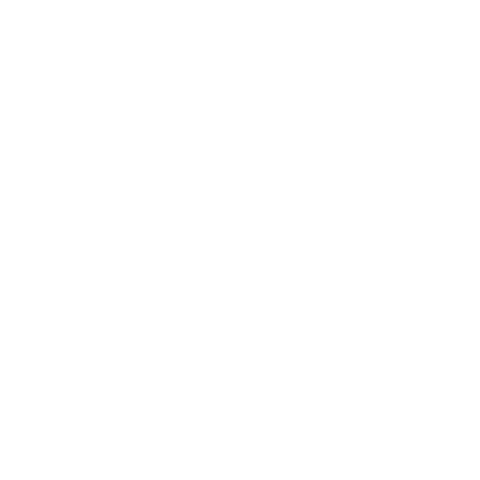Lorsque deux personnes se séparent après avoir vécu ensemble sans être mariées, la question du partage des biens se pose inévitablement, surtout si elles ont acquis du patrimoine en commun. Que vous soyez concubins ou partenaires pacsés, les règles ne sont pas les mêmes, et il est essentiel de connaître vos droits pour éviter les mauvaises surprises.
Sommaire
1.Concubinage et PACS: deux cadres juridiques très différents
Le concubinage est une union de fait, sans aucun statut juridique spécifique. Il ne crée aucun droit particulier entre les concubins, y compris sur le plan patrimonial.
Le PACS, en revanche, est un contrat conclu entre deux personnes majeures, qui encadre leur vie commune et permet d’opter pour un régime de séparation ou d’indivision.
Cette différence de statut a un impact direct sur le partage des biens en cas de séparation.

2.Le partage des biens entre concubins
Aucune présomption de propriété conjointe
En concubinage, chaque concubin reste propriétaire des biens qu’il a achetés seul, peu importe que le couple ait vécu ensemble ou non.
Les biens achetés ensemble sont en indivision. Par défaut, la quote-part de chacun est celle figurant dans l’acte d’achat (souvent 50/50).
Si un seul des deux a financé une part plus importante, il devra en apporter la preuve pour espérer obtenir un rééquilibrage (via une créance ou une indemnité).
ATTENTION: lorsque l’un des concubins paye seul le prêt relatif à un immeuble indivis, la créance de remboursement ne se prescrit pas pendant le concubinage à la différence des couples mariés ou PACSES, cela signifie qu’au delà de 5 ans, le concubin qui a remboursé seul ne pourra rien demander à l’autre.
Risques en cas de contribution déséquilibrée
Si un concubin a contribué financièrement à l’acquisition d’un bien au nom de l’autre (sans être propriétaire), il peut tenter d’obtenir un remboursement sur le fondement :
De l’enrichissement sans cause,
Ou d’une société créée de fait, en prouvant une gestion commune du patrimoine.
Mais ces actions sont complexes et incertaines : aucun droit n’est automatiquement reconnu sans preuve d’accord ou de participation réelle.
3.Et si on anticipait ? La convention de concubinage
Même si le concubinage ne crée pas de lien juridique entre les partenaires, il est tout à fait possible — et recommandé — de conclure une convention écrite pour organiser certains aspects de la vie commune et anticiper les conséquences d’une éventuelle séparation.
Cette convention de concubinage permet notamment de :
Répartir les charges de la vie commune (loyer, factures, crédits, dépenses du quotidien),
Préciser la propriété de certains biens, notamment ceux acquis ensemble,
Définir à l’avance les modalités de sortie d’indivision ou de remboursement d’apports financiers,
Désigner le juge compétent en cas de litige (dans les limites du droit français),
Anticiper la loi applicable, par exemple en cas de concubinage international.
Cette convention n’a pas la même valeur juridique qu’un contrat de mariage ou un PACS, mais elle peut constituer un élément de preuve déterminant en cas de conflit, notamment devant les juridictions civiles.
Elle peut être rédigée sous seing privé, par acte d’avocat ou devant notaire, ce qui en renforce la sécurité juridique et la lisibilité.

4. Le partage des biens entre partenaires pacsés
Deux régimes possibles : séparation ou indivision
Lors de la conclusion du PACS, les partenaires peuvent opter pour :
Le régime de séparation de biens (régime par défaut depuis 2007) : chacun reste propriétaire de ce qu’il acquiert seul.
Le régime de l’indivision : tous les biens acquis pendant le PACS sont réputés appartenir à moitié à chacun, sauf mention contraire.
Ce choix a une incidence directe sur le partage des biens en cas de rupture.
En cas de séparation
Si les partenaires sont en séparation de biens, chaque partenaire récupère ce qu’il a acheté. Les biens acquis ensemble sont partagés selon les quotes-parts mentionnées dans les actes.
En régime d’indivision, les biens sont en principe partagés à parts égales, sauf preuve contraire.
En cas de désaccord sur le partage, le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi pour trancher. Il peut également désigner un notaire pour procéder à la liquidation de l’indivision.

5. Partage d’un bien indivis : que faire en cas de conflit ?
Qu’il s’agisse de concubins ou de partenaires pacsés, lorsqu’un bien a été acheté ensemble et qu’aucun accord n’est trouvé, la sortie d’indivision peut être demandée :
Soit à l’amiable : vente du bien et répartition du prix selon les quotes-parts,
Soit judiciairement : en saisissant le tribunal judiciaire, (ou le JAF pour les partenaires pacsés pour solliciter la jouissance provisoire du bien indivis moyennant une indemnité d’occupation)
Le juge pourra :
Ordonner la vente du bien,
Attribuer le bien à l’un des deux avec indemnisation de l’autre,
Fixer des créances pour compenser des apports déséquilibrés.

6. L’importance d’un accompagnement juridique
Faire appel à un avocat permet :
D’étudier vos droits et de déterminer si vous pouvez revendiquer une quote-part ou une créance,
De négocier un partage amiable en bonne et due forme, y compris par la rédaction d’une convention de rupture,
De vous représenter devant le JAF ou le tribunal judiciaire en cas de conflit,
Et, dans le cadre d’un PACS, de faire homologuer un accord amiable par le juge, pour lui donner la valeur d’un jugement.