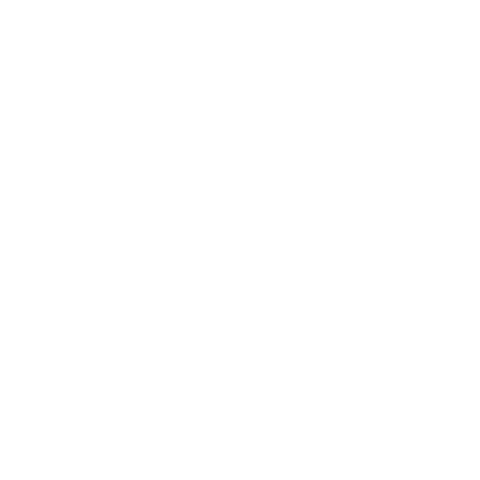Peut-on encore parler de “placement” quand un enfant reste chez ses parents ?
Jusqu’à récemment, certains juges prononçaient des placements à l’Aide sociale à l’enfance (ASE)… tout en laissant l’enfant vivre au domicile d’un parent. Cette pratique, appelée « placement à domicile », était très utilisée, mais juridiquement floue.
Désormais, la Cour de cassation a tranché : ce type de placement n’est plus possible. Lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, il doit être physiquement éloigné de ses parents. Cette décision met fin à une pratique ambiguë, et clarifie les droits et devoirs de chacun.
Sommaire
1.Qu’est-ce que le placement à l’ASE ?
Le placement à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est une mesure de protection qui permet de retirer un enfant de son milieu familial lorsque celui-ci est considéré comme dangereux pour lui. L’enfant peut alors être accueilli :
– dans une structure spécialisée (foyer ou maison d’enfants),
– dans une famille d’accueil.
Mais cela suppose une séparation physique avec le ou les parents.

2.Pourquoi ne peut-on pas placer un enfant à l’ASE tout en le laissant chez ses parents ?
Dans un arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation a rappelé clairement que le placement à l’ASE ne peut pas se faire au domicile des parents.
Si l’enfant reste chez ses parents, ce n’est plus un placement, mais une autre forme d’intervention éducative.
Cela peut paraître surprenant : depuis des années, certains juges utilisaient cette solution dite de « placement éducatif à domicile », pensant qu’il s’agissait d’une mesure plus souple.
Or, pour la Cour, il s’agit d’un oxymore juridique : un enfant ne peut pas être « placé » tout en restant chez les personnes dont on veut justement le protéger.

3.Quelle alternative pour les juges ?
Le juge a deux options :
– Soit l’enfant est réellement en danger, et dans ce cas il est confié à l’ASE, donc retiré physiquement du domicile parental.
– Soit l’enfant peut rester chez ses parents, mais dans ce cas le juge prononce une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforçée (AEMO R). Cette mesure permet un accompagnement éducatif renforcé à domicile, mais ce n’est pas un placement.
En cas de placement de l’enfant à l’ASE, le juge peut autoriser des hébergements ponctuels, par exemple pendant les week-ends ou les vacances, mais jamais en continu.

4.Pourquoi cette clarification est importante ?
Cette jurisprudence permet de :
– Mieux protéger les enfants, en évitant des mesures « à moitié » protectrices.
– Clarifier la responsabilité de chacun : en cas de placement réel, c’est l’ASE qui est responsable de l’enfant, pas les parents.
– Éviter les confusions : pour les familles comme pour les services éducatifs, les mots doivent avoir un sens clair.

5.Ce que dit la Cour de cassation ?
Dans plusieurs décisions récentes, la Cour a censuré des juges qui ordonnaient un placement à l’ASE tout en laissant l’enfant chez ses parents. Elle a précisé qu’un placement signifie nécessairement que l’enfant est confié à un tiers, pas à ses propres parents.
Elle appelle les juges à respecter la distinction entre placement (séparation) et AEMO (accompagnement à domicile), au nom de la cohérence du droit et de l’efficacité de la protection de l’enfance.
5.Ce qu’il faut retenir
– Le placement à l’ASE suppose une séparation physique de l’enfant avec ses parents.
– L’enfant ne peut pas être placé à l’ASE tout en restant chez sa mère ou son père.
– Si l’enfant reste chez ses parents, ce n’est pas un placement mais une mesure éducative à domicile (AEMO).
– La Cour de cassation a rappelé cette règle à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 12 juin 2025.