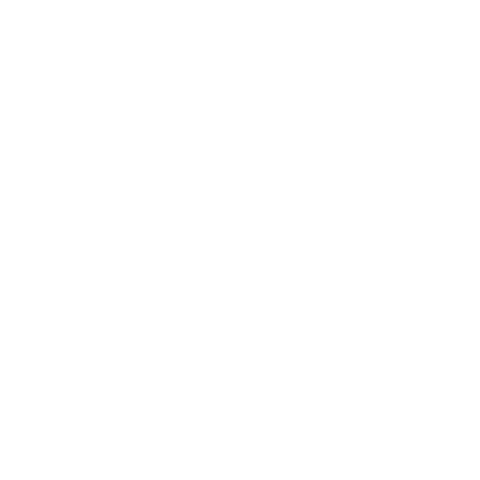Lors d’un divorce, la séparation ne met pas seulement fin à la vie conjugale. Elle peut aussi créer un déséquilibre économique entre les ex-époux. C’est pour compenser cette disparité que le législateur a prévu ce que l’on appelle la prestation compensatoire.
Sommaire
1.Qu’est-ce que la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme d’argent ou un avantage en nature versé par un époux à l’autre pour compenser la baisse du niveau de vie que la rupture du mariage va engendrer.
Elle ne vise pas à corriger des fautes ni à sanctionner un comportement : elle repose uniquement sur un critère économique. Elle est donc indépendante du régime matrimonial des époux.
Elle peut être prévue :
dans un divorce par consentement mutuel (elle est alors fixée d’un commun accord par les avocats des deux époux dans la convention de divorce),
ou fixée par le juge dans le cadre d’un divorce judiciaire, lorsqu’il constate une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

2.Comment la prestation compensatoire est-elle évaluée ?
Il n’existe pas de barème légal pour déterminer le montant de la prestation compensatoire. Elle est fixée en fonction de la situation concrète des époux au moment du divorce.
Le juge (ou les avocats en cas d’accord) prend en compte plusieurs critères :
La durée du mariage
L’âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelles
Les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune (par exemple, un conjoint ayant mis sa carrière entre parenthèses pour élever les enfants)
Leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, prévisible ou déjà existant
Les droits existants en matière de retraite
Un simulateur indicatif existe, proposé par le ministère de la Justice. Il ne remplace pas une analyse juridique sur mesure, mais permet d’obtenir une première estimation en renseignant certains critères : Simulateur de prestation compensatoire

3.Sous quelle forme la prestation compensatoire peut-elle être versée ?
La prestation compensatoire est en principe versée sous forme de capital, c’est-à-dire :
soit en une seule fois, par virement ou chèque
soit de manière échelonnée, sur une durée maximale de 8 ans (ce que l’on appelle un « capital libéré en plusieurs fois »)
Exceptionnellement, elle peut aussi prendre d’autres formes :
L’attribution d’un bien (par exemple, un bien immobilier appartenant à l’époux débiteur)
Un droit d’usage et d’habitation, permettant à l’époux bénéficiaire de continuer à occuper un logement appartenant à l’autre
Une rente viagère, mais cette solution reste rare et est en général réservée aux situations particulières (âge avancé, état de santé précaire, absence totale de revenus…)

4.Dans quels cas peut-on demander une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire n’est pas automatique. Elle suppose l’existence d’une disparité significative dans les conditions de vie des époux au moment du divorce.
Cette disparité peut résulter de plusieurs éléments :
Une différence notable de revenus : salaires, revenus professionnels ou pensions.
Un écart de patrimoine, en particulier lorsque ce patrimoine est productif de revenus (loyers, placements financiers, dividendes…).
Au-delà des ressources, plusieurs critères légaux sont pris en compte, tels que :
La durée du mariage
L’âge des époux
Leur état de santé
Leurs qualifications professionnelles
Les sacrifices de carrière réalisés au bénéfice du conjoint ou de la famille (par exemple, un arrêt d’activité pour élever les enfants)
La situation à la retraite (droits déjà ouverts ou prévisibles)
Un autre critère souvent mal compris est celui du niveau de vie.
Il ne s’agit pas seulement de comparer les revenus, mais d’évaluer le train de vie global des époux pendant le mariage. Ainsi, deux époux disposant de revenus confortables mais ayant toujours mené une vie simple seront jugés sur le niveau de vie effectivement adopté, pas sur leur potentiel de consommation.
En principe, il est toujours préférable de s’accorder à l’amiable sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire.
Cela permet :
de limiter les coûts
de raccourcir les délais
et surtout, de maîtriser l’issue du litige.
À défaut d’accord, c’est le juge aux affaires familiales qui tranchera. Il appréciera les éléments au jour où il statue, y compris s’il intervient en appel. Cela signifie qu’un changement de situation (perte d’emploi, vente d’un bien, amélioration de carrière…) survenu après le jugement de première instance peut influencer la décision finale.
Il faut avoir conscience que l’aléa judiciaire est important : d’un tribunal à l’autre, voire d’un juge à l’autre, l’interprétation des critères peut varier fortement. Se faire accompagner par un avocat permet d’anticiper ces disparités et de mieux défendre sa position.

5.Quelle est la fiscalité de la prestation compensatoire
La fiscalité de la prestation compensatoire dépend de sa forme et des délais de versement :
Versement en capital dans les 12 mois du jugement de divorce :
Déductible du revenu imposable pour l’époux débiteur
Non imposable pour l’époux bénéficiaire Réduction d’impôt :
Versement en capital sur plus de 12 mois : Assimilée à une pension alimentaire
Déductible pour celui qui verse Imposable pour celui qui reçoit
Versement sous forme de rente viagère :
Déductible pour le débiteur Imposable pour le bénéficiaire
Cette distinction est essentielle pour anticiper les conséquences fiscales du divorce.

6.Pourquoi choisir notre cabinet ?
La prestation compensatoire soulève souvent des enjeux sensibles.
Elle suppose une analyse précise de votre situation économique et de celle de votre epoux(se),
Une analyse pointue des critères
mais aussi une vraie stratégie pour anticiper les risques fiscaux ou patrimoniaux.
Notre cabinet, exclusivement dédié au droit de la famille, vous aide à :
évaluer la pertinence d’une demande ou d’un refus de prestation compensatoire
chiffrer un montant réaliste au regard de votre situation
défendre efficacement vos intérêts dans un cadre amiable ou contentieux.
Nous proposons des honoraires transparents et fixés à l’avance.